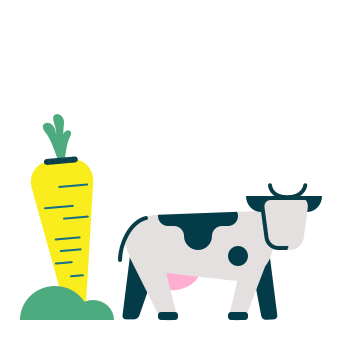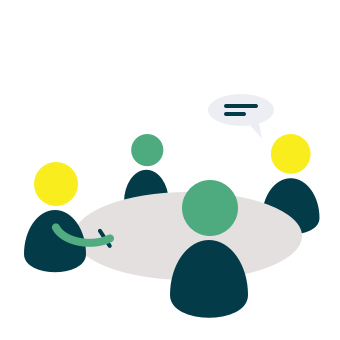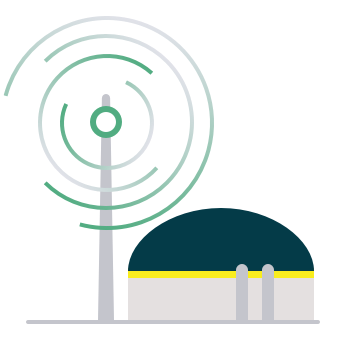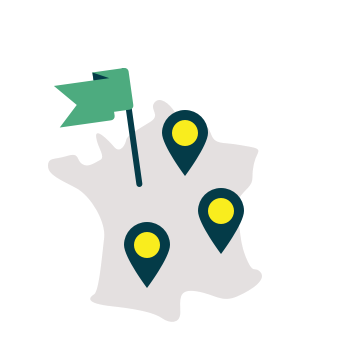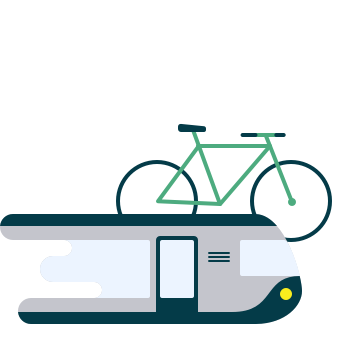Non, on ne veut pas vous interdire de manger de la viande
La France fait partie des pays où l’on mange le plus de viande. En effet, on en consomme deux fois plus que la moyenne mondiale, ce qui représente aussi deux fois plus que la génération de nos grands-parents. La question prioritaire n’est donc pas d’arrêter totalement de manger de la viande, c’est avant tout de retrouver une certaine modération dans notre consommation.

Pourquoi réduire sa consommation de viande est bon pour le climat et la santé
Cela a un véritable impact sur nos émissions de gaz à effet de serre : l’ensemble des aliments que l’on consomme représente 22% de l’empreinte carbone de la France. Or la première source d’émissions de gaz à effet de serre de notre alimentation est la viande et les autres produits d’origine animale, qui représentent 61% des émissions de notre assiette.
C’est aussi notre santé qui est en jeu : en France, on consomme trop de protéines animales, avec un risque accru de diabète, maladies cardiovasculaires, cancers… À l’inverse, nos menus, trop pauvres en légumes, légumineuses (comme les lentilles) et fruits à coque sont sources de carences, par exemple en fibres.
Une réduction de viande de 50 % par rapport à notre régime actuel permettrait non seulement de réduire nos émissions de gaz à effet de serre mais aussi de satisfaire l’ensemble des apports nutritionnels recommandés !
Un exemple de régime pour protéger sa santé et le climat :
- Par semaine : pas plus de 4 à 5 repas avec de la viande
- Par jour :
- 5 fruits et légumes
- 2 produits laitiers
- 1 portion de céréales complètes
- 1 portion de légumineuses
- 2 petites poignées de fruits à coque
Et n’oublions pas la provenance : aujourd’hui, 30% de la viande consommée en France est importée de l’étranger. Manger moins de viande mais mieux, c’est privilégier une viande locale et issue d’élevages durables, qui permettra de mieux rémunérer les éleveuses et les éleveurs français !
Pour aller plus loin : Comment concilier nutrition et climat ?
La voiture électrique est une partie de la solution pour nos mobilités
Le véhicule électrique est la meilleure alternative au véhicule thermique pour celles et ceux qui dépendent de la voiture. Moins émettrice de CO2, elle permet de réduire l’impact sur le climat de notre parc automobile. De plus, son efficacité grandit à mesure que sa taille rétrécit ! En revanche, il est essentiel de faire évoluer notre système de transport, de manière à réduire la place prépondérante de la voiture dans nos mobilités. C’est une nécessité environnementale, mais aussi sociale.

Pourquoi la voiture électrique répond – en partie – à nos besoins
En France, de la construction à la fin d’utilisation, les émissions de gaz à effet de serre de la voiture électrique sont 2 à 5 fois plus faibles que celles de la voiture thermique[1]. Oui, la production d’un véhicule électrique émet du CO2 au moment de sa production, en particulier au moment de l’extraction des ressources nécessaire à la confection de la batterie. Ce n’est donc pas un véhicule “propre”. Mais sur l’ensemble de son cycle de vie, le bilan reste nettement meilleur que celui d’un véhicule électrique.
De plus, ce bilan peut encore être nettement amélioré, notamment en réduisant la taille des véhicules et donc des batteries utilisées. Par rapport à une petite voiture électrique, un gros SUV électrique représente deux fois plus d’émissions de gaz à effet de serre et cinq fois plus de ressources rares pour la construction[2]. Un véhicule lourd est aussi plus cher : environ 3 000 € de plus à l’achat tous les 100 kg supplémentaires[3]. C’est donc un moyen de transport moins compatible avec la transition écologique et l’accès à la mobilité. Pour les hybrides, qui pèsent très lourd et sont souvent des SUV, c’est le même constat. L’analyse du cycle de vie des hybrides rechargeables révèle un bilan carbone bien au-dessus des véhicules 100% électriques[4].
Attention, la voiture électrique est loin d’être parfaite : remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques n’est pas la solution. En effet, bien que moins impactant pour le climat, le véhicule électrique n’est pas neutre et ne suffira pas à atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Surtout, il ne résout pas les autres enjeux liés à la voiture : accidents, pollution de l’air, métaux critiques, structuration de l’espace public et de l’aménagement du territoire …
Alors oui, le véhicule électrique est plus vertueux que le véhicule thermique, d’autant plus s’il est petit et sobre. Mais à condition de trouver sa place dans un nouveau système de avec de multiples modes de transports, mieux adapté aux besoins de mobilités des citoyens.
Les éoliennes sont une source d’énergie efficace (et même indispensable !)
On entend tout et surtout n’importe quoi sur les éoliennes, une source d’énergie pourtant indispensable : la sortie des énergies carbonées est une urgence absolue dans un monde qui se dirige vers un réchauffement de 3,1°C.

Pourquoi les éoliennes sont une source d’énergie fiable
Les éoliennes modernes sont capables de capter des vents plus faibles, plus forts, plus hauts et donc de façon plus stable. Elles sont donc capables de produire beaucoup d’énergie : en moyenne, une seule éolienne de 4 MW fournit de quoi alimenter environ 1400 foyers (chauffage compris), et le secteur continue de progresser.
Il n’est donc pas nécessaire de “recouvrir la France d’éoliennes” comme on l’entend parfois. En termes de surface, le besoin est inférieur à ce qu’on utilise chaque année pour construire de nouvelles routes. Pour un scénario 100% renouvelables, on estime que 25 à 35 000 éoliennes sont nécessaires, or 10 000 sont déjà construites.
Et non, un jour sans vent n’occasionne pas de coupures de courant. On sait prévoir assez précisément la production éolienne avec un jour d’avance. C’est suffisant pour être flexible et mobiliser d’autres sources d’énergie comme l’hydroélectricité, le stockage ou en utilisant le réseau : on importe de l’énergie d’autres régions où le vent souffle davantage à ce moment-là.
Quant à leur esthétique, rappelons qu’une centrale à gaz ou à charbon n’est pas forcément plus agréable à regarder. Face à l’urgence climatique, aucune option n’est idéale, mais on a besoin d’électricité et pas le choix de sortir des énergies fossiles, bien plus néfastes sur tous les aspects.
Quel que soit le mix électrique, le développement des énergies renouvelables est incontournable, associé à des mesures de flexibilité, de sobriété et d’efficacité énergétique pour réduire notre demande. L’énergie éolienne est une alternative fiable, efficace et la moins chère aujourd’hui !
La transition écologique crée beaucoup plus d’emplois qu’elle n’en supprime
L’idée que la transition écologique supprime des emplois est toujours répandue, mais elle ne tient pas compte de l’ensemble des transformations de la société. En réalité, elle pourrait en réalité générer jusqu’à 550 000 emplois nets supplémentaires d’ici à 2030[5], et au total 3 millions de postes à pourvoir, soit près de 10 % de l’emploi en France !

Pourquoi la transition est une opportunité pour l’emploi
Ce mouvement est déjà en plein essor : la transition énergétique représente aujourd’hui plus de 420 000 emplois, avec une croissance de 24 % entre 2020 et 2022[6]. Cela concerne en particulier les secteurs des énergies renouvelables, des mobilités durables et du bâtiment (à travers la rénovation énergétique).
Toutefois, il est vrai que la transition écologique a un impact majeur sur l’emploi : il est indispensable d’accompagner cette évolution pour assurer une transition juste. Certains secteurs d’activité sont amenés à décroître, et donc à voir des emplois disparaître et/ou se transformer. Les salariés ne doivent pas payer le prix de ces profondes transformations, qui ne peuvent pas être synonymes de licenciements et de précarité.
Il s’agit donc de penser des outils et des dispositifs d’anticipation et d’accompagnement de ces salariés. Cela implique des dispositifs de formation et de reconversion professionnelle, mais aussi des systèmes de gouvernance locale adaptée, avec une planification partagée entre entreprises, pouvoirs publics et acteurs territoriaux. Enfin, les emplois créés doivent être attractifs et de qualité pour garantir une transition écologique sans précarisation. En renforçant les coopérations locales et en valorisant les initiatives réussies, il est possible de construire une économie durable, créatrice d’emplois et bénéfique pour tous
Des leviers pour une économie durable et créatrice d’emplois :
- anticipation,
- respect du dialogue social,
- recherche de stratégies économiques d’entreprise qui favorise la transition et le maintien dans l’emploi,
- accompagnement renforcé des salariés et des territoires les plus touchés dans une logique de résilience
En conclusion, loin d’être une menace, la transition écologique est une formidable opportunité économique et sociale, à condition de reposer sur une anticipation proactive, des coopérations locales renforcées et des dispositifs ciblés pour accompagner salariés, entreprises et territoires.
Pour aller plus loin :
Agir pour le climat est économiquement avantageux
Non, la France ne va pas se ruiner si elle déploie des moyens financiers pour lutter contre le climat : c’est même le contraire ! Toutes les études montrent que le coût de l’inaction climatique sera bien plus élevé que celui de l’action. Investir dans la transition aujourd’hui, c’est éviter des dépenses colossales et limiter des impacts catastrophiques dans le futur.

Pourquoi l’inaction coûtera plus cher que l’action
On estime que la France a déjà perdu 120 milliards d’euros entre 1980 et 2024 à cause des épisodes météorologiques extrêmes[7] (inondations, canicules, sécheresses, feux de forêts…) qui sont de plus en plus fréquents et intenses au fur et à mesure que la Terre se réchauffe. Ces épisodes génèrent des coûts pour la santé, la réparation des bâtiments endommagés, des pertes agricoles, etc. À l’échelle mondiale, 90% des catastrophes sont liées aux conditions météorologiques et climatiques, et les pertes économiques s’élèvent à 520 milliards de dollars chaque année selon l’ONU[8].
De nombreuses études, dont le rapport du GIEC, démontrent que plus les gouvernements prennent de retard, plus ces impacts économiques seront importants. Par exemple, cette récente publication dans la revue Nature estime que le coût de l’inaction serait 6 fois plus élevé que celui d’une action immédiate[9]. En France, une politique d’inaction climatique pourrait coûter près de 7 points de PIB par an à l’horizon 2100[10]. Financer l’action contre le changement climatique, c’est à la fois œuvrer pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre – seule solution pour limiter tous ces impacts – et mettre en place des politiques d’adaptation pour se protéger des catastrophes qu’on ne pourra éviter. De plus, même dans un cadre de déficit, les économistes démontrent que couper les subventions au climat est aberrant : ça n’a aucun bénéfice sur le fond, et ça ne fera que retarder les emprunts nécessaires[11] ! C’est pourquoi même l’endettement est préférable : il sera toujours moins important aujourd’hui que si on laissait la situation s’enliser.
Pour finir, il ne faut bien sûr pas oublier les pertes inestimables liées au changement climatique : effondrement de la biodiversité, risques sanitaires graves, aggravation des inégalités, migrations forcées, transformation des paysages… Les coûts générés par l’inaction vont bien au-delà des aspects financiers.
La vraie écologie punitive, c’est de ne rien faire
“Marre de l’écologie punitive !” : c’est la réaction qu’on entend beaucoup lorsqu’on évoque certaines mesures pour lutter contre le changement climatique. Mais ne rien faire aura des conséquences bien plus contraignantes sur notre quotidien.

Pourquoi ne rien faire est bien plus contraignant que les « solutions écolos »
Certes, réduire nos émissions de gaz à effet de serre va demander des efforts : réduire sa consommation d’énergie, manger moins de viande, limiter ses voyages en avion… Mais la vraie punition, ce seront les conséquences du changement climatique si nous ne prenons pas des mesures drastiques dès maintenant. Ne pas pouvoir sortir de chez soi à cause des canicules atteignant 50 °C, subir des restrictions d’eau la plupart des étés, voir les paysages de notre enfance disparaître, affronter des inondations ou des incendies de plus en plus souvent… Ce n’est pas de la science fiction, c’est ce qui nous attend au cours du siècle si nos émissions de gaz à effet de serre poursuivent leur trajectoire actuelle !
Malgré tout, pour être efficaces, les mesures pour lutter contre le changement climatique doivent être pensées collectivement, avec des mesures adaptées et des efforts répartis de manière juste. L’action individuelle est indispensable mais insuffisante : sans action des pouvoirs publics pour permettre à tous d’adopter des pratiques et une consommation plus responsable, elle restera vaine.
Pour aller plus loin : Les impacts du changement climatique en France
La capture du carbone ne suffira pas à compenser nos émissions
La réduction de nos émissions de gaz à effet de serre est absolument nécessaire pour limiter le changement climatique et ses effets néfastes, et aucune technologie ne permettra de nous en passer.

Pourquoi la technologie n’est pas la solution à tous nos problèmes
L’idée selon laquelle « la technologie nous sauvera » et qu’il suffit de compenser nos émissions est séduisante, mais elle repose sur une vision simpliste. Les méthodes de capture et de stockage du carbone reposent à l’heure actuelle sur des technologies spéculatives dont l’efficacité reste très limitée, et présentant des risques pour la biodiversité, puisqu’elles ont des répercussions sur les écosystèmes, et pour les droits humains, en accaparant des terres, menaçant dans certains cas les moyens de subsistance locaux et en retardant la transition vers des solutions réellement durables. Par ailleurs, les industriels souhaitant recourir à ces technologies énergivores et très coûteuses demandent le soutien de l’État – et donc cela risque de peser sur les ménages.
Elles ne doivent pas détourner nos efforts des vraies solutions pour atteindre la neutralité carbone, à commencer par sortir des énergies fossiles, développer les énergies renouvelables, et déployer des mesures de sobriété. Ces technologies seront alors utiles pour traiter les émissions résiduelles, c’est-à-dire celles que nous n’aurons pas réussi à éliminer et que les puits de carbone naturels (comme les forêts, les sols et les océans) ne pourront pas absorber.
Enfin, la transition écologique doit aller au-delà de la simple réduction des émissions : elle implique de transformer un système économique orienté vers la production, un système qui détruit les écosystèmes, épuise les ressources naturelles, aggrave la crise climatique et creuse les inégalités sociales. Il ne s’agit pas seulement de réduire le CO2, mais de construire un modèle durable et équitable pour tous.
Bonus : « La France n’est pas responsable »
« Il est trop tard pour agir », « La France n’est pas responsable, demandez aux vrais pollueurs », « Le climat a toujours changé, on n’y peut rien ! »… Vous avez probablement déjà été confrontés à ces arguments, qui poussent à l’inaction ou pire, flirtent avec le climatoscepticisme : retrouvez comment contrecarrer ces arguments dans notre page « Réponses aux climatosceptiques » !
Notes et références
[1] Bon Pote – La voiture électrique, solution idéale pour le climat ?
[2] Métaux critiques : le WWF France alerte sur les SUV électriques
[3] Cf. Aurélien Bigo sur Twitter/X
[4] Voir Bon Pote – Les voitures hybrides rechargeables, fausse solution pour le climat
[5] Gouvernement – Stratégie emplois et compétences pour la planification écologique
[6] ADEME – Transition énergétique : quelles perspectives pour l’emploi ?
[7] Oxfam – Rapport « Changement climatique : nous ne sommes pas prêts » (2024)
[8] ONU – La crise climatique – Nous pouvons gagner la course
[9] Kotz, M., Levermann, A. & Wenz, L. The economic commitment of climate change. Nature, 551–557 (2024)
[10] ADEME – Les risques climatiques et leurs coûts pour la France