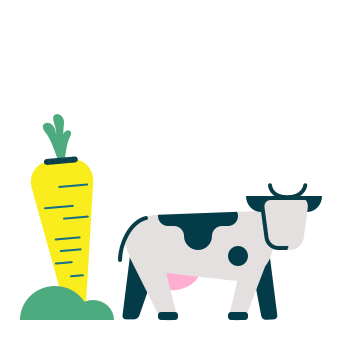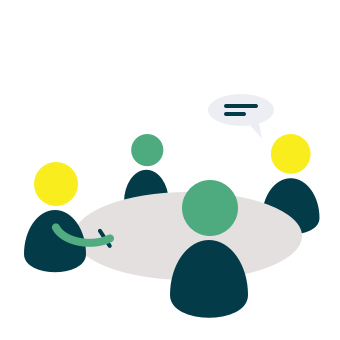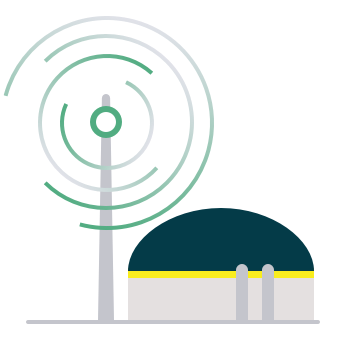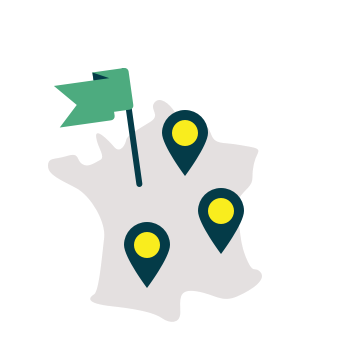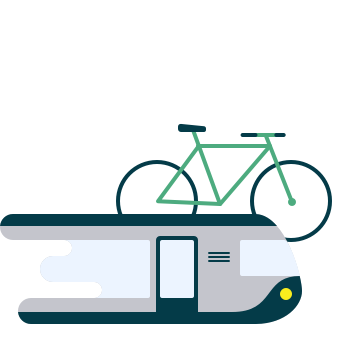Surcapacité électrique : une menace pour la transition énergétique ?
Le Réseau Action Climat alerte contre les réactions égoïstes et court-termistes face à la situation actuelle de surcapacité électrique. Celles-ci risquent sérieusement de menacer la transition énergétique, en soutenant des consommations superflues, ou en mettant à l’arrêt le déploiement des renouvelables.

Dans le débat français sur l’électricité, la situation actuelle inquiète notamment parce que le pays connaît une situation de “surcapacité”, c’est-à-dire une production électrique bien plus élevée que la demande. Celle-ci est attribuée à une trop faible augmentation de la demande électrique par rapport à ce qui était prévu ; tandis que les moyens de production électrique renouvelable se déploient, que les centrales nucléaires historiques ont été prolongées, et que l’EPR de Flamanville continue, bien que difficilement, sa montée en puissance.
Économiquement, une production accrue pousse à la baisse le prix de marché de l’électricité, augmente le nombre d’heures à prix nul, voire négatif dans certaines conditions, et diminue donc la rentabilité intrinsèque des centrales électriques. Cela se traduit par des pertes de rentabilité, ou par l’augmentation du soutien public.
En réaction, plusieurs acteurs, dont le Haut Commissaire à l’Energie Atomique (HCEA), demandent de freiner grandement le développement des renouvelables, notamment celui du photovoltaïque.
Pour le Réseau Action Climat, il importe d’interroger les origines de la surcapacité, et de tirer profit de la situation en suivant une trajectoire ambitieuse vers la sortie des fossiles. A l’inverse, nous alertons contre les réactions égoïstes et court-termistes qui risquent sérieusement de menacer la transition énergétique, en soutenant des consommations superflues, ou en mettant à l’arrêt le déploiement des renouvelables
Les origines de la surcapacité
La première cause désignée de la surcapacité, c’est la faible hausse de la consommation électrique. C’est une réalité : En 2024, RTE estime la consommation (corrigée des aléas) à 449 TWh, alors qu’elle était d’environ 480 TWh entre 2011 et 2017.
A première vue, les défenseurs d’une politique ambitieuse de sobriété énergétique pourraient se réjouir. Il est vrai qu’une partie de cette baisse vient d’une meilleure efficacité de certaines consommations d’électricité, et d’actions de sobriété, notamment chez les ménages.
Mais, une grande partie de la baisse de la consommation est due à l’augmentation des prix de l’énergie qui ont contraint le budget des ménages. Le prix régulé de vente de l’électricité, qui est le prix payé par 70% de la population, est ainsi passé de moins de 20 centimes par kWh avant l’invasion russe de 2022, à presque 30 centimes au plus fort de la crise, et n’est récemment redescendu à environ 25 centimes qu’en février 2025.
Comme en témoignent les chiffres de l’Observatoire National de la Précarité Energétique (ONPE), 30% d’entre nous avons subi le froid durant l’hiver 2023-2024, et les ¾ d’entre nous avons restreint le chauffage pour ne pas payer trop cher.
De même, le Haut Conseil pour le Climat constatait, dans son rapport de 2023, que 45% des baisses d’émission dans l’industrie sont imputables à une baisse d’activité.
Ainsi, une partie des baisses de consommation électrique résulte de la désindustrialisation et de la précarité, plutôt que d’une sobriété réelle et collectivement organisée.
A l’inverse, il est impératif que la consommation électrique se développe dans certains secteurs pour sortir effectivement du gaz et du pétrole, qui nous coûtent entre 50 et 60 milliards d’euros chaque année. A entendre certains discours, l’apathie dans les secteurs en transition serait naturelle, presque aléatoire, ou résulterait du manque d’engagement des consommateurs.
Or, cette transition demande d’importants investissements, par exemple le renforcement de lignes de trains, l’achat d’une voiture électrique, ou encore la définition et la réalisation d’un plan de rénovation globale permettant le passage à la pompe à chaleur. Ceux-ci ne peuvent pas, ou difficilement être faits par une grande partie de la population, tandis que beaucoup parmi ceux qui en ont les moyens n’en voient pas l’intérêt. Nous pensons notamment aux propriétaires bailleurs, qui ne veulent pas financer des travaux et laissent leurs locataires payer les factures.
Depuis plusieurs années, le gouvernement acte recul sur recul dans le financement de la transition écologique. En contradiction avec ses propres feuilles de route, il a par exemple diminué en 2025 le financement de la rénovation des logements et les aides à l’électrification des véhicules, pourtant des piliers majeurs d’électrification. De plus, le manque de visibilité créé par la dissolution politique de juin 2024, et les retards successifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, puis le choix de l’acter par décret plutôt que par une loi dédiée, retardent les décisions définitives d’investissement dans les filières en transition, et découragent ceux dédiés aux filières de la transition.
Rappelons donc, avant toute chose, que le gouvernement ne peut se défaire de sa responsabilité face au faible rythme de l’électrification en France. Son soutien financier, réglementaire et symbolique est de fait essentiel pour sortir des fossiles.
Les premières réactions à la lenteur de l’électrification sont délétères.
D’une part il serait contre-productif de chercher à augmenter la consommation d’électricité à tout prix, sans en questionner les usages. Il importe en effet d’interroger l’utilité sociale et la soutenabilité environnementale de chaque projet. Par exemple, doit-on construire d’immenses data-centers pour améliorer l’efficacité des publicités ciblées ? Est-il souhaitable que les algorithmes énergivores de l’IA générative se répandent dans tous les domaines ?
En changeant de source d’énergie. l’électrification est la voie la plus accessible pour sortir des fossiles. Mais elle ne doit pas se résumer à une multiplication des usages énergétiques.
D’autre part, la réaction de la filière du nucléaire et de ses soutiens à la situation actuelle est de s’opposer aux renouvelables pour maintenir sa part de marché, ce qui est particulièrement néfaste pour le moyen et long terme.
Pour le Réseau Action Climat, ni l’addition déraisonnée de consommations d’électricité, ni le ralentissement du développement des renouvelables, ne sont des solutions souhaitables pour l’avenir énergétique de la France.
Alors, comment mieux réagir face à la surcapacité actuelle ?
Nucléaire contre renouvelables ?
D’une part, nous devons dénoncer les discours demandant de ralentir l’installation d’énergies renouvelables sous prétexte qu’elles seraient “incompatibles avec le nucléaire”.
Si les scénarios énergétiques s’accordent sur un certain nombre de constats, il existe autant de scénarios de décarbonation différents reposant sur les énergies renouvelables, avec des mix et des niveaux de consommation différents, que de scénarios donnant une place plus ou moins importante au nucléaire, et dans lesquels les énergies renouvelables produisent quand même, en général, plus de la moitié de l’électricité en 2050. Un scénario extrême, celui du Rassemblement National défend, sans programme chiffré, un système énergétique qui reposera encore largement sur des hydrocarbures importés en 2050.
Aussi, le mix énergétique de 2050 résultera essentiellement de choix de politiques publiques, et non de forces mécaniques et intangibles. Mais à ce jour, aucune formule n’a été trouvée permettant de concilier ralentissement des renouvelables et sortie des fossiles.
A long terme, la compatibilité entre électricité renouvelable et électricité nucléaire n’est pas une donnée scientifique, mais bien un choix politique. Cependant, l’intégralité des scénarios énergétiques permettant la sortie des fossiles exigent d’accélérer, ou a minima de maintenir le rythme actuel d’installation d’énergies renouvelables sans discontinuer.
A court terme, l’ajout de production renouvelable soutiendra dans un premier temps les exportations, et réduira donc la production carbonée dans les pays voisins via les interconnexions européennes.
Mais ensuite, sans augmentation de la consommation, l’ajout de production conduira mécaniquement à devoir choisir quelles centrales utiliser et lesquelles brider ou mettre à l’arrêt. Or, les énergies renouvelables ne consommant pas de matière première, elles sont capables de vendre leur énergie à n’importe quel prix (pourvu qu’il soit positif).
Actuellement, en Europe, le choix des centrales appelées et de celles mises de côté découle du marché de l’énergie, qui priorise les centrales au coût de fonctionnement le plus faible.
Le même phénomène fait aussi que l’addition de production renouvelable fait baisser les prix de gros de l’électricité. Cette baisse de prix réduit de fait la rentabilité des centrales existantes, et en particulier celle des centrales nucléaires (mais aussi celle des énergies renouvelables existantes). Selon les modalités du soutien public, cette perte de rentabilité est portée par la puissance publique, ou par les entreprises détentrices des centrales. Mais pour les consommateurs d’électricité, ménages ou entreprises, elle allège les factures et encourage l’électrification.
En somme, il est juste de dire qu’à court terme, l’ajout d’électricité renouvelable réduit les prix de gros moyen de l’énergie. Cela réduit de fait la rentabilité du nucléaire, comme elle diminue celle des renouvelables, pour les producteurs d’énergie.
Tirer de ce constat la conclusion qu’il faut ralentir l’installation de renouvelables serait faire preuve d’une vision défavorable aux consommateurs, en plus d’être court-termiste, et ultimement préjudiciable à la sortie des énergies fossiles.
Faire le choix de l’ambition
Doit-on subir la surcapacité comme une crise ? Si on adopte uniquement la posture des producteurs d’électricité, a fortiori nucléaire, évidemment oui ! Pour eux, les prix nuls ou négatifs, et même les prix bas sont une mauvaise nouvelle à court terme, tandis que l’augmentation, justifiée ou pas, de la consommation électrique en est une bonne.
Mais pour celles et ceux pour qui la défense d’une transition énergétique juste, planifiée et complète est une priorité, la surcapacité est à considérer comme une longueur d’avance et une opportunité à saisir.
Avant tout, notons que juguler le déploiement des renouvelables, ou ralentir les économies d’énergie, irait totalement à l’encontre de l’atteinte des objectifs de décarbonation et de sortie des fossiles. Aucun scénario de décarbonation ne permet de faire l’impasse sur l’électrification d’un grand nombre d’usages, et tous constatent que les centrales nucléaires qu’il est possible de construire ne pourront au plus que remplacer le parc existant.
Pour être prêts à faire face à l’augmentation de la consommation électrique, l’augmentation de la capacité renouvelable est nécessaire, quitte à assumer une surproduction temporaire. Mieux, cette situation fait baisser les prix et doit encourager l’électrification, sans explosion des usages superflus.
Il n’est pas possible d’attendre que la demande électrique augmente avant de rattraper les retards de déploiement des renouvelables. Ce retard accumulé conduira uniquement à des importations d’énergie, ou au recours à des moyens onéreux et polluants.
Toutefois, nous devons reconnaître que le photovoltaïque est l’énergie renouvelable dont l’essor est le plus flagrant, ce qui pousse le gouvernement à vouloir le modérer, mais que son développement n’est pas soutenable si c’est la seule énergie à se développer. En effet, l’électricité solaire est disponible seulement en journée, et s’il existe quelques solutions pour la rendre plus constante (panneaux verticaux, héliostats), elle ne saurait répondre seule à nos besoins. Elle oblige à maintenir en fonctionnement les centrales nucléaires existantes, en les poussant à moduler de plus en plus leur production pour produire lorsqu’il n’y a pas de soleil, mais qu’il reste une demande électrique importante.
Cependant, le photovoltaïque peut s’inscrire dans un mix de solutions complémentaires : éolien terrestre et en mer, flexibilité de la demande, sobriété et efficacité, interconnexions, stockage, etc, afin d’offrir une production d’électricité plus régulière, capable de mieux répondre à la demande française et européenne.
Déployer un tel mix complémentaire permettra de répondre efficacement à la demande électrique, mais aussi d’encourager l’électrification en France et en Europe. Mais si la demande continue, au moins temporairement, de stagner, déployer un mix complémentaire permet d’anticiper l’arrêt partiel ou complet d’une ou plusieurs centrales nucléaires.
Si ce choix n’est pas souhaitable pour les industriels du nucléaire, du point de vue du système électrique, il permet d’anticiper l’effet falaise, c’est-à-dire l’arrêt consécutif d’un grand nombre de centrales nucléaires dans un court laps de temps.
Notons que cette solution a son intérêt aussi bien dans la perspective d’une sortie complète de la production d’électricité nucléaire, avec un arrêt progressif des réacteurs au fur et à mesure de leur remplacement par des solutions renouvelables complémentaires, que dans la perspective d’un remplacement du parc nucléaire, où l’arrêt des réacteurs actuel peut être anticipé, évitant les coupures subies ou simultanées, et laissant petit à petit la place aux nouveaux réacteurs.
En somme, faire primer l’intérêt des citoyens et de l’environnement sur les intérêts particuliers des producteurs d’électricité conduit à déployer à un rythme soutenu un mix complémentaire de solutions renouvelables, de flexibilités et d’économies d’énergie, permettant de répondre au besoin croissant d’électricité.
La question des modèles économiques des centrales, aussi bien renouvelables que nucléaires, est une autre question à traiter, mais qui ne doit pas empêcher de penser la transition énergétique dans une perspective systémique et de long terme.
-
-
-
Suivez les actualités du réseau
Abonnez-vous à la newsletter du Réseau Action Climat.