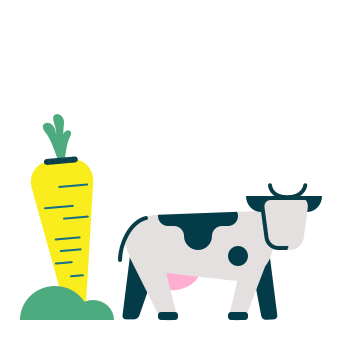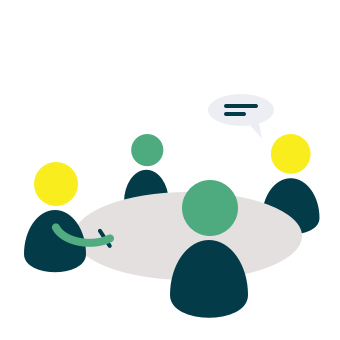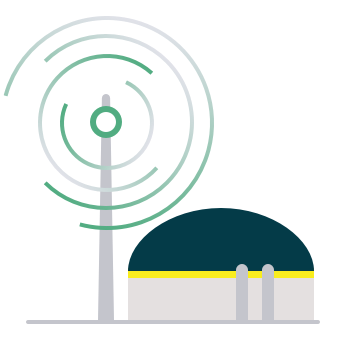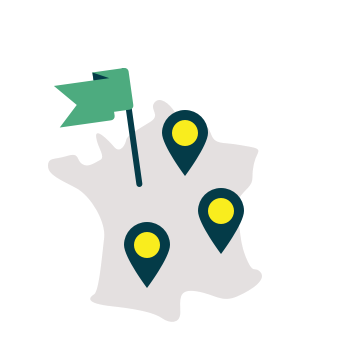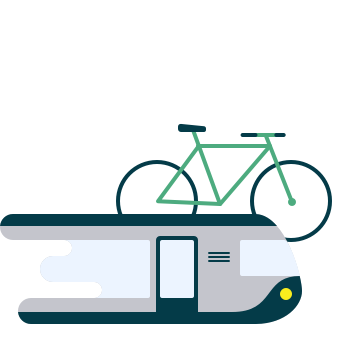Les Outre-mer, grands oubliés de la diplomatie climatique française
À l’approche de la COP30 à Belém, le Réseau Action Climat publie une analyse pour rappeler une évidence trop souvent ignorée : les territoires ultramarins, qui concentrent 80% de la biodiversité française et subissent de plein fouet les effets du dérèglement climatique, demeurent marginalisés dans la diplomatie française sur le climat.

Deuxième puissance maritime mondiale, la France doit cette position internationale en grande partie grâce à l’héritage d’un empire colonial dont les territoires ultramarins sont le prolongement. Répartis sur plusieurs océans (Atlantique, Indien, Pacifique et Austral), les territoires d’outre-mer sont le résultat de dominations coloniales, de mouvements de résistances et de relations asymétriques qui perdurent aujourd’hui dans la diplomatie dite “française”.
Érosions, cyclones, montée des eaux, dégradation des écosystèmes…. Malgré une grande vulnérabilité face aux impacts du changement climatique, les Outre-mer n’ont pourtant qu’une place symbolique dans les négociations internationales climatiques. Minimiser le rôle des populations qui habitent et défendent ces territoires constitue un manquement stratégique majeur : c’est priver ces écosystèmes de leur meilleure défense et risquer leur disparition.
Les Outre-mer français : des espaces stratégiques vulnérables et marginalisés
Les Outre-mer se trouvent aujourd’hui dans une position contradictoire : ils renforcent l’influence internationale de la France sans bénéficier d’une autonomie suffisante. À l’occasion des COP par exemple, les territoires ultra-marins n’ont pas de délégation propre : leur représentation est désignée par Paris et intégrée dans la délégation française, leur participation n’étant pas systématique.
Certains, comme la Polynésie française, ont pu envoyer de petites délégations autonomes, mais celles-ci ne sont pas intégrées à la délégation française ce qui restreint considérablement leur capacité d’action au sein des négociations. Cette intégration reste un levier politique essentiel.
La diplomatie française nie la pluralité et l’expertise ultramarine
Des Antilles à la Guyane, de l’océan Indien au Pacifique, les territoires ultramarins français se caractérisent par une diversité géographique, culturelle et institutionnelle.
Mais l’approche uniforme et centralisée de la pratique diplomatique française efface ces différences. La loi Zéro Artificialisation Nette (ZAN) en est une illustration éloquente : vouloir stopper toute progression nette de l’artificialisation des sols d’ici 2050 se heurte dans les Outre-mer à une réalité plus complexe. Pression démographique, inégalités foncières, vulnérabilité climatique extrême… La rareté des terres constructibles oblige souvent à urbaniser des espaces pourtant essentiels pour l’adaptation et la protection des populations.
Par ailleurs, l’inclusion effective des catégories les plus marginalisées, à l’image des peuples autochtones, reste lacunaire. Le recrutement diplomatique et le choix des représentantes et représentants officiels reproduisent trop souvent des élites locales éloignées des réalités sociales propres à ces espaces.
Pistes concrètes pour une diplomatie climatique plus inclusive
1. Former et autonomiser les négociateurs et négociatrices ultramarins sur le climat
Un obstacle récurrent est le manque d’accès des représentant·e·s ultramarin·e·s aux formations diplomatiques de haut niveau. Il est nécessaire pour y remédier de développer des programmes de formation et des viviers de jeunes négociateurs et négociatrices issus de chaque territoire. La mise en place de formations universitaires dédiées permettrait également de renforcer profondément l’autonomie intellectuelle et politique des futures générations ultramarines.
2. Assurer une représentation pluraliste et transparente lors des sommets internationaux
Pour assurer la présence systématique de représentant·e·s issu·e·s de différents territoires et appartenances sociales, il faut appliquer des critères clairs de sélection dans toutes les délégations. Au Canada par exemple, la participation des représentant·e·s autochtones dans les délégations officielles est structurée et institutionnalisée.
3. Soutenir l’autonomie diplomatique régionale
Certaines collectivités ultramarines, notamment dans le Pacifique, disposent déjà d’une capacité d’action propre dans leur région, illustrant la possibilité d’une diplomatie partiellement décentralisée. Pour étendre cette dynamique à d’autres bassins ultramarins, il faut renforcer les moyens dédiés à leurs représentations régionales. Les démarches de coopération autonome, à l’image de l’alliance Guyane-Amapá, doivent en outre être soutenues et institutionnalisées.
4. Organiser des Assises de la diplomatie des Outre-mer
Formulée dans le rapport d’information du Sénat, cette proposition permettrait d’instaurer un rendez-vous régulier associant société civile, territoires et État pour co-construire la stratégie diplomatique, notamment sur le volet climatique.
5. Garantir une représentation effective aux COP pour chaque territoire
Établir une diplomatie climatique juste et inclusive nécessite notamment un engagement de la France à s’assurer de la présence systématique d’au moins un·e représentant·e de chacun de ses territoires ultramarins au sein de sa délégation officielle aux COP. Cette évolution présente plusieurs bénéfices, tels que la visibilité accrue de la diversité au cœur des négociations internationales ou encore la valorisation des expertises locales.

-
-
-
Suivez les actualités du réseau
Abonnez-vous à la newsletter du Réseau Action Climat.