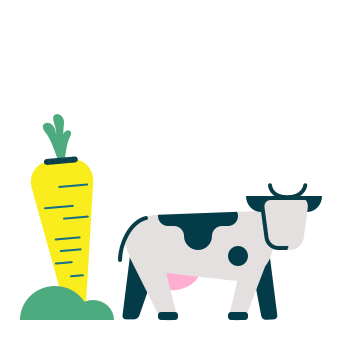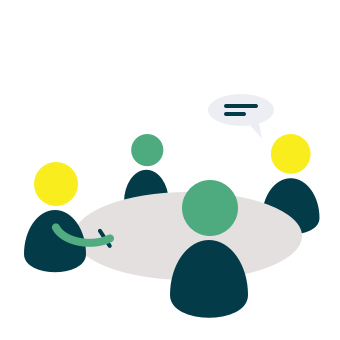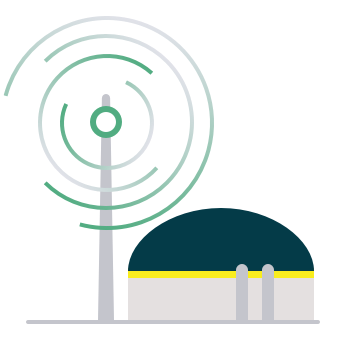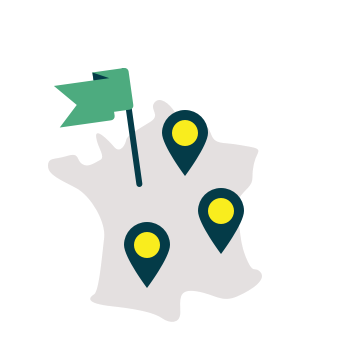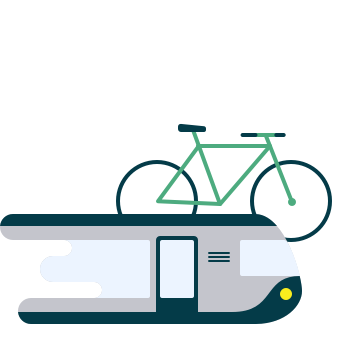COP30 au Brésil : l’heure de la résistance pour les 10 ans de l’Accord de Paris
L’ouragan Melissa qui a frappé les îles des Caraïbes est un rappel cruel de la nécessité d’une transition juste : les populations les plus pauvres sont les plus vulnérables face au changement climatique, alors qu’elles en sont les moins responsables. La COP30 doit être l'occasion de porter des solutions écologiques et justes.

Alors que la crise climatique s’accélère et que les records de chaleur sont battus, le monde a encore connu une hausse record d’émissions de CO2 en 2024. Parallèlement à cela, le multilatéralisme fait l’objet d’attaques de toutes parts, notamment en raison d’un vent d’autoritarisme qui souffle dans de nombreux pays du monde. Cela a déjà des conséquences très concrètes sur les populations, les libertés et les droits humains étant à chaque fois entravés.
Dans ce contexte, la COP30 qui se tiendra à Bélem, au Brésil, du 10 au 21 novembre 2025, doit être un tournant. Dix ans après son adoption, l’Accord de Paris de la COP21 s’impose toujours comme le seul outil multilatéral capable de fixer un cap collectif face à la crise climatique. Cet anniversaire nous oblige à faire un pas de côté pour prendre du recul : quelles actions se sont concrétisées ? Quelles promesses ont été tenues ou brisées ? Le Réseau Action Climat revient sur cette décennie décisive et formule ses recommandations.
L’Accord de Paris : l’étoile polaire climatique
En 2015, la signature de l’Accord de Paris a permis d’engager tous les États dans la lutte contre le réchauffement climatique en donnant la possibilité à chacun de fixer ses propres objectifs, tout en maintenant un cadre contraignant en matière de transparence et de redevabilité. C’est le début des contributions déterminées à l’échelon national (CDN).
L’objectif commun : contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C.
Tous les 5 ans, les 195 Parties signataires doivent maintenant soumettre des Plans climat plus ambitieux pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Tous les pays n’ont pas les mêmes engagements, car leurs responsabilités dans la crise climatique actuelle et leurs capacités à y faire face diffèrent.
Les engagements pris grâce à l’Accord de Paris ont permis de freiner significativement la hausse des températures, les trajectoires de réchauffement passant d’environ 4 °C projetés d’ici 2100 à environ 2,5 °C. Si on arrive à la mise en œuvre complète de tous les plans climat nationaux, y compris les objectifs de neutralité carbone et les stratégies à long terme, cela permettrait de limiter le réchauffement à environ 1,9 °C selon le scénario optimiste du Climate Action Tracker.
L’objectif des 1,5°C de réchauffement est-il déjà dépassé ?
L’année 2024 a été la plus chaude jamais mesurée dans le monde, avec +1,52 °C par rapport à 1850-1900. Pourtant, cela ne signifie pas que nous avons déjà dépassé la limite des 1,5°C fixée par l’Accord de Paris. En effet, la température mondiale est évaluée sur une moyenne d’au moins vingt ans. D’un point de vue scientifique, il faudra donc attendre encore plusieurs années avant de savoir avec certitude si le seuil de 1,5°C a été atteint. Cependant, nous savons que si les émissions ne diminuent pas rapidement, le dépassement pourrait survenir dès 2030 (Climate Analytics).
Ce constat ne doit pas être une invitation au défaitisme : le dépassement de ce seuil ne signifie pas la fin des engagements. Au-delà de 1,5°C de réchauffement planétaire, chaque dixième de réchauffement supplémentaire viendra avec son lot de conséquences désastreuses pour les conditions d’habitabilité de notre planète. On ne s’arrête pas de courir lorsqu’on est en retard, au contraire, on accélère : c’est la mission qui doit motiver les pays du monde dès maintenant et au cours des prochaines décennies.
La sortie des énergies fossiles : nouvel objectif fragile depuis la COP28
La référence explicite à la sortie des fossiles n’est une victoire que trop récente, obtenue après de multiples batailles contre les lobbies de l’industrie, qui se tiennent en rang serré contre toute tentative de progrès. Leur présence grandissante lors des COP (ils se comptent désormais par milliers) est aussi le signe d’une menace, la nôtre, celle de la société civile, sur leurs profits.
La COP28 a permis d’enfin briser le tabou avec l’adoption d’un accord international posant la première pierre d’une transition hors de toutes les énergies fossiles : pétrole, gaz et charbon. Mais dans la pratique… Les États producteurs prévoient de produire, d’ici à la fin de la décennie, 120 % de plus que le volume de combustibles fossiles nécessaire pour limiter le réchauffement à 1,5 °C (OIC).
Chaque nouvelle infrastructure, susceptible de fonctionner plusieurs dizaines d’années, menace de nous verrouiller un peu plus dans un système énergétique climaticide. Et ce sont les pays riches qui sont très majoritairement responsables de cette augmentation de la production de pétrole et de gaz.
TotalEnergies ou la croissance sans fin d’un monde sous perfusion de pétrole
Récemment condamné par la justice pour greenwashing car il se présentait comme un « acteur majeur de la transition énergétique », le géant français des hydrocarbures fait partie des 20 plus grands émetteurs historiques de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, TotalEnergies arrive en tête des entreprises détenant en portefeuille le plus grand nombre de projets fossiles et de bombes carbone dans le monde, avec 154 projets.
Depuis la signature de l’Accord de Paris en 2015, et jusqu’en avril 2023, TotalEnergies a été impliqué dans 84 nouveaux projets différents d’exploration fossile. Et aujourd’hui, loin de choisir la voie de la réduction pourtant nécessaire, TotalEnergies prévoit d’augmenter encore la production. Le PDG de l’entreprise Patrick Pouyanné a affirmé vouloir l’augmenter de 3% par an jusqu’à 2030. TotalEnergies a prévu de porter ⅔ de ses investissements dans les énergies fossiles d’ici à 2030.

Pour une transition juste qui ne tombe pas dans le colonialisme vert
Le concept de transition juste souligne l’importance de mettre en œuvre les mesures climatiques tout en engageant et protégeant les personnes et communautés vulnérables. Reconnu dans le préambule de l’Accord de Paris, il prend en compte les considérations d’équité globale notamment entre les pays du Nord et du Sud.
Le financement d’une transition juste hors des combustibles fossiles reste un défi majeur, particulièrement pour les pays en développement. Le soutien des pays développés reste trop limité et mal coordonné, tandis que l’accès aux financements climatiques existants est souvent entravé par des procédures complexes et des obstacles institutionnels.
Alors que 70% des minéraux indispensables à la transition énergétique se trouvent dans les pays du Sud, les retombées économiques y demeurent minimes (Oxfam). La lutte contre le changement climatique tend à devenir un prétexte pour reproduire des rapports de prédation hérités de l’époque coloniale. Ainsi, la concentration des investissements, des brevets et des technologies vertes entre les mains des pays du Nord fait que ceux qui possèdent les ressources n’en maîtrisent ni les chaînes de valeur, ni les innovations qui en découlent.
Le Mécanisme d’action de Bélem au secours de la transition juste
Nous avons absolument besoin d’un organe permanent pour éviter une approche fragmentée et injuste de la transition : le Mécanisme d’action de Belém. Sa mission serait de coordonner et d’accélérer les efforts pour que la transition soit réellement équitable. Ce mécanisme permettrait de transformer une promesse en architecture institutionnelle, en intégrant pleinement les principes d’équité et de responsabilités communes mais différenciées. Il fournirait aux pays le soutien, les moyens et la redevabilité nécessaires pour garantir que les travailleurs et travailleuses, et les communautés restent au centre des politiques climatiques, tout en levant les obstacles qui freinent la transformation des économies. Sans justice sociale et économique, la transition écologique restera un mirage. À Belém, il est temps de passer de la rhétorique à l’action et de faire de la transition juste une réalité

“Make Our Planet Great Again”… mais les émissions stagnent à la maison
Si la France s’est fixée pour objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050, la planification écologique n’a toujours pas été officialisée et la Stratégie nationale bas carbone se fait toujours attendre. Loin d’être à la hauteur, les politiques publiques mises en œuvre par les gouvernements successifs depuis plus d’un an ont au contraire acté de graves reculs en matière de transition écologique.
Résultat : la réduction des émissions de gaz à effet de serre nationales en 2024 ralentit de façon alarmante, allant trois fois moins vite qu’en 2023. Elles n’ont ainsi reculé que de 1,8% en 2024, contre 5,8% en 2023 (Ministère de la transition écologique) et, pire, elles stagnent depuis le début de l’année 2025. Pour rappel, la baisse de nos émissions devrait être de l’ordre de 5% par an pour respecter la trajectoire vers la neutralité carbone en 2050.
L’effondrement du puits de carbone forestier, du fait de la hausse de la mortalité des arbres, devrait d’ailleurs nous pousser à redoubler d’efforts : il n’en est rien pour l’instant. Au contraire, le recul de la France sur les questions climatiques se constate au niveau national, européen et international.
Les pays du Sud méritent mieux que des miettes et des dettes
Pilier de l’Accord de Paris, le financement climatique ne fait toujours pas l’objet d’une définition claire et partagée. Les besoins financiers des pays en développement, pour engager ou accélérer la transition écologique, mais aussi pour s’adapter et faire face aux impacts, sont pourtant colossaux. Ils se chiffrent déjà en milliers de milliards d’euros pour les prochaines années.
Cette situation est aggravée par la crise de la dette : plus de 60 % des pays à faible revenu sont aujourd’hui en situation de surendettement ou à haut risque (Banque mondiale). Ainsi, plus de 3,3 milliards de personnes vivent dans des pays consacrant plus d’argent au paiement des intérêts de leur dette qu’à l’éducation ou aux soins médicaux.
Aujourd’hui, l’architecture financière internationale montre ses limites, et les appels à sa réforme se font de plus en plus pressants. Les règles qui encadrent les flux Nord-Sud doivent être repensées en profondeur : cela passera notamment par l’annulation des dettes insoutenables ou illégitimes par tous les créanciers, mais aussi un financement climatique adéquat de la part des pays riches pollueurs, qui soit fondé sur des dons.
Une réforme nécessaire pour relégitimer les COP climat
La CCNUCC traverse une crise de légitimité. Les COP se sont multipliées en taille et en visibilité, mais sans réussir à garantir la justice climatique ni à contraindre les principaux pollueurs. Pire : elles ont marginalisé les pays vulnérables, les peuples autochtones et la société civile, tout en laissant les pays riches et les industries fossiles échapper à leurs responsabilités [United call for an urgent reform of the UN Climate Talks]. Dans de trop nombreux cas, l’accueil des COP dans des États autoritaires ou liés aux intérêts fossiles, et la présence massive de lobbyistes fossiles, ont encore fragilisé le processus et entaché sa crédibilité.
Pourtant, les COP restent le seul espace multilatéral où les États se réunissent chaque année pour discuter du climat. C’est pourquoi il est urgent de réformer leur fonctionnement, afin qu’elles redeviennent des espaces d’action efficaces, transparents et démocratiques.
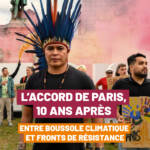
-
-
-
Suivez les actualités du réseau
Abonnez-vous à la newsletter du Réseau Action Climat.