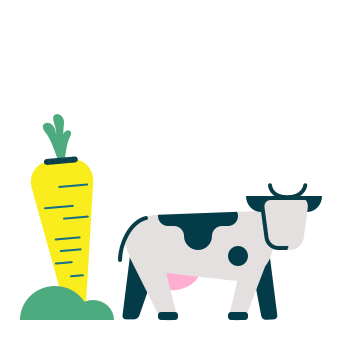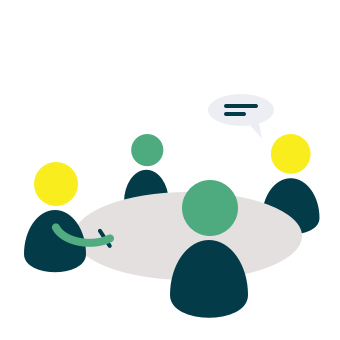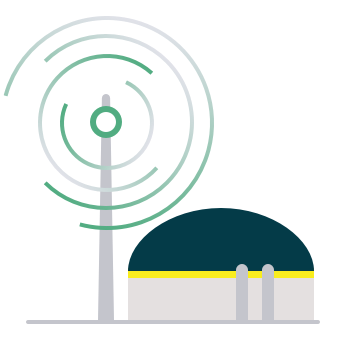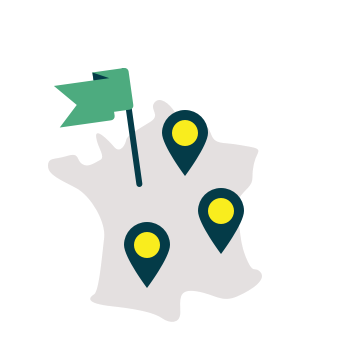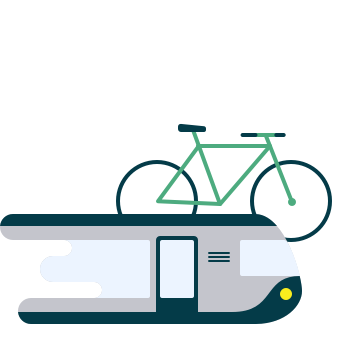Comment renforcer le cadre pluriannuel du financement de la transition écologique ?
En 2024, pour la 1ère fois, le gouvernement a publié sa trajectoire de financements de la transition écologique (la SPFTE). En 2025, le gouvernement doit publier une nouvelle version de cet outil de planification, l’occasion de faire le point sur les enjeux majeurs derrière cet acronyme obscur.

La transition écologique souffre d’un sous-financement chronique
Dans leur rapport publié en 2023, Pisani-Ferry & Mahfouz estimaient que pour atteindre nos objectifs climatiques, nous aurions besoin d’investir 66 milliards d’euros supplémentaires par an dans la transition écologique d’ici 2030, à part égale entre les investissements privés et publics. Cela implique au moins 10 milliards d’euros de pur budgétaire par an. Cela signifie que pour atteindre nos objectifs climatiques il va nous falloir faire en 10 ans ce qu’on a peiné à faire en trente. Sans compter que chaque année, la France continue de saper ses propres efforts en finançant plus de 15 milliards de dépenses néfastes pour la biodiversité et le climat, à rebours de la transition écologique.
Entre 2023 et 2025 : une dynamique budgétaire coupée dans son élan
Grâce à la dynamique lancée par ce rapport et dans un contexte de soutien politique à la planification écologique par le gouvernement, entre 2023 et 2024, les financements alloués à la transition écologique avaient fortement augmenté, avec +8 milliards d’euros pour la transition écologique inscrits dans le budget 2024 adopté fin 2023. Mais suite à ce pas en avant et dans un contexte budgétaire fortement dégradé en 2024, l’Etat a annoncé 40 milliards d’euros de coupe dans le budget 2025. Alors que le coût de l’inaction climatique a été largement démontré, l’écologie a fait partie des principaux secteurs touchés : selon nos calculs, le budget 2025 adopté le 14 février rabote les budgets de la transition écologique d’au moins 4 milliards d’euros. Les financements de la transition écologique pourraient continuer à se dégrader : le gouvernement a annoncé 40 milliards d’euros de coupes supplémentaires dans le budget 2026.
La “SPFTE” : derrière l’acronyme, un outil clé pour éviter les reculs et le saupoudrage budgétaire
La SPFTE est la 1ère en son genre. En effet, la France est le seul Etat européen à avoir développé cet outil indispensable pour planifier sur plusieurs années les financements (publics et privés) pour la transition écologique, pour donner de la visibilité aux industries, aux entreprises, aux acteurs financiers, et pour planifier les mesures d’accompagnement des ménages et des collectivités dans la transition écologique.
La 1ère édition de la feuille de route publiée en septembre 2024 pose des bases essentielles mais avec beaucoup de marges de progression :
- Elle permet d’identifier les grands postes de dépense, un préalable à tout exercice de planification. Mais elle ne va pas assez loin en matière d’orientation pour le fléchage de l’argent public alors que ça serait indispensable de sécuriser le fléchage sur les ménages aux bas revenu ou vers les investissements à la rentabilité longue. En outre, la première SPFTE s’inscrit dans une trajectoire de réduction du déficit budgétaire et ne prévoit pas pour l’instant d’augmentation des budgets. Pourtant, augmenter les budgets pour la transition écologique nécessite une réflexion approfondie sur les nouvelles recettes et mécanismes financiers à mettre en place pour y arriver.
- Elle rappelle que la transition écologique nécessite de mobiliser des investissements supplémentaires, et ces chiffres sont cohérents avec les calculs du rapport Pisani-Mahfouz. Mais elle se fait porter l’essentiel de l’effort sur les flux financiers privés, sans prévoir d’augmentation des financements publics. Il sera très important d’actionner des leviers de financements publics supplémentaires dans la prochaine version, et de préciser les outils pour mobiliser des financements privés additionnels (par exemple, une réglementation pour contraindre les propriétaires-bailleurs à accélérer la rénovation des logements).
- Elle reconnaît le rôle-clé des collectivités dans le déploiement et le financement de la transition écologique et fait une liste exhaustive des aides disponibles. Il sera important que la prochaine itération de la SPFTE propose une feuille de route pour le financement de la transition écologique par les collectivités.
- Sur la question épineuse des dépenses néfastes, elle apporte des chiffres nouveaux et précieux, jusqu’ici non publics : par exemple, l’exonération de taxe sur le kérosène des avions et le taux de TVA réduit sur les billets d’avions représentent un manque à gagner pour l’Etat de 3,6 milliards d’euros et 170 millions respectivement ; le fait que le gazole soit moins taxé que l’essence représente une dépense de 3,3 milliards d’euros pour l’Etat. En publiant ces chiffres, la SPFTE permet d’éclairer le débat.
Un enjeu de la prochaine SPFTE : anticiper les enjeux sociaux et économiques sur le long terme
Aujourd’hui, la plupart des prévisions associées au financement de la transition écologique ne prennent pas suffisamment en compte les dimensions politiques, sociales et économiques susceptibles d’évoluer à moyen et long terme. La SPFTE est conçue comme un outil de pilotage de l’action publique pourtant elle intère peu l’évolution possible des contextes économiques, sociaux ou politiques, ce qui limite sa capacité à éclairer les choix à venir. Sans forcément tout prévoir, mieux anticiper permettrait pourtant de construire des trajectoires plus robustes et de donner davantage de visibilité aux acteurs. Résultat, l’évaluation de l’impact sur les ménages reste très partielle, alors même que les dynamiques sociales (emplois, prix, mobilités, inégalités) sont au cœur de l’acceptabilité de la transition. Cette analyse est partagée à la fois par les associations mais aussi par les économistes et experts du sujet. Par exemple, pour rappel le rapport Pisani Ferry et Selma Mahfouz disposait très clairement que “En France comme dans les autres pays avancés, chacun voit bien que des efforts vont être demandés à tous. Dans ce contexte, il est attendu des politiques climatiques qu’elles soient efficaces, mais aussi qu’elles soient justes. C’est par l’opinion sur leurs impacts distributifs, presque autant que par le jugement quant à leurs incidences sur la réduction des émissions, que s’explique le degré de soutien dont bénéficient les nombreux avatars de ces politiques”
Anticiper, c’est aussi orienter. La question de l’horizon temporel des modèles – où commence notre calcul, où s’arrête-t-il – n’est pas qu’une affaire de technicien : c’est un choix politique qui détermine la trajectoire que l’on veut tracer. C’est sur cette base que doivent être construites des décisions robustes, capables d’encourager l’investissement privé tout en assumant les choix collectifs nécessaires
Vers une loi du financement pluriannuel de la transition écologique ?
Traduire cet outil en loi permettrait de transformer la logique budgétaire de la transition écologique, en la sortant du court-termisme et du saupoudrage pour en faire un cadre structurant, pluriannuel et lisible.
Une telle loi pourrait :
- S’appuyer sur les enseignements des prochaines SPFTE, enrichies d’estimations plus robustes et de scénarios dynamiques prenant en compte les incertitudes ;
- Définir des engagements financiers publics sur plusieurs années, à l’image d’une « loi de programmation des finances vertes » ;
- Intégrer des outils d’arbitrage budgétaire explicite, afin de hiérarchiser les dépenses en fonction de leur impact environnemental, social et territorial ;
- Offrir une visibilité aux collectivités, entreprises et ménages, en sécurisant les trajectoires d’investissement dans la transition.
La transition ne peut être une variable d’ajustement. Elle doit devenir l’ossature des choix budgétaires, à la hauteur de l’urgence et des transformations à venir.
-
-
-
Suivez les actualités du réseau
Abonnez-vous à la newsletter du Réseau Action Climat.