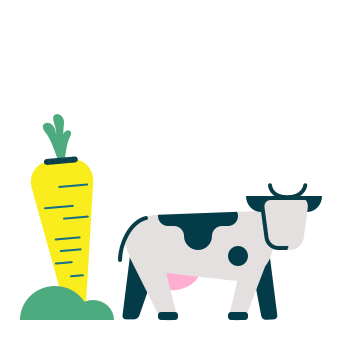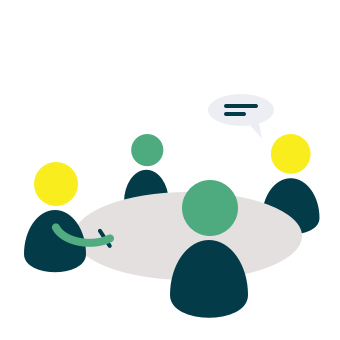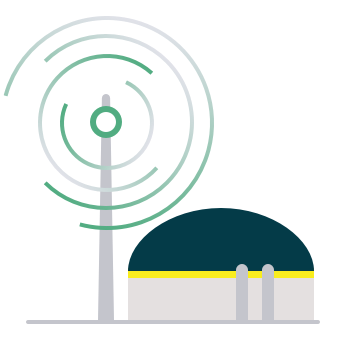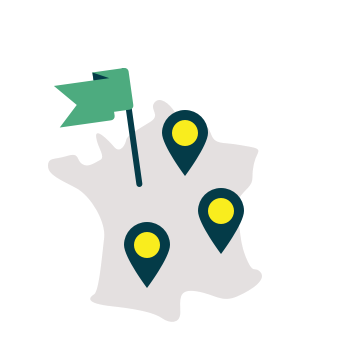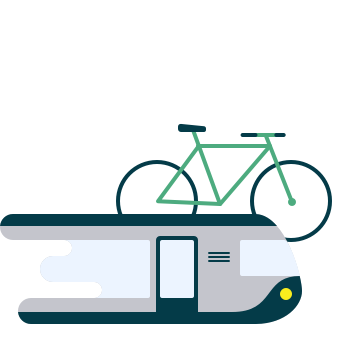À Bonn : Préparation d’une COP dans un contexte de guerres internationales
De retour des négociations climat qui se tenaient à Bonn en juin, nos expertes décryptent l’évolution des discussions sur fond de guerres, crise de confiance entre les États et vagues de chaleur dans plusieurs régions du monde.

Une société civile déterminée : Il est encore temps de se battre pour l’Accord de Paris
L’objectif de limiter le réchauffement à 1,5 ℃, bien que de plus en plus difficile à atteindre selon les dernières analyses scientifiques, doit rester une boussole collective. Chaque dixième de degré compte : si l’objectif de 1,5 ℃ s’éloigne, il ne s’agit pas de baisser les bras, mais de redoubler d’efforts pour éviter un emballement climatique. Comme le rappelait l’ONU, chaque fraction de degré supplémentaire a des conséquences majeures sur les écosystèmes et les sociétés humaines, en particulier les plus vulnérables1.
Dans ce contexte, les intersessions de la CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques) tenues à Bonn en Juin 2025, ont constitué une étape cruciale dans la préparation de la COP 30, en réunissant négociateurs.trices, expert.e.s et représentant.e.s de la société civile autour des grands enjeux climatiques actuels. Ces discussions se sont déroulées dans un contexte d’urgence accrue pour le climat avec des vagues de chaleur dans plusieurs régions du monde, d’une crise de confiance dans le multilatéralisme, mais aussi dans une recherche croissante de justice au sein de la transition écologique. Les tensions étant à leur comble, entre le génocide en Palestine et les bombardements en Iran et en Ukraine, nous assistons peut-être à une des années les plus difficiles pour réaliser une COP ambitieuse, à la hauteur des multiples crises que nous vivons. Et, peut-être que l’ambition ne se lit pas toujours dans les discours des dirigeant·e·s, mais elle est bien là, portée chaque jour, par une société civile déterminée et prête à prendre la mer pour Belèm.
Quelques avancées mais des lacunes majeures : l’ambition et le financement
Nous avons eu un début frustrant, des progrès extrêmement lents, puis une accélération finale a permis d’aboutir à des accords sur plusieurs sujets, mais deux lacunes majeures restent non traitées. Premièrement, celle de l’ambition climatique : les nouveaux plans climatiques des pays (les Contributions Déterminées Nationales – CDN) risquent fort de produire un écart important par rapport aux réductions d’émissions nécessaires. Et à ce jour, la présidence brésilienne de la COP n’a toujours pas présenté de plan clair pour gérer ce sujet à la COP30. Ce besoin est crucial et pour la première fois, plusieurs pays ont publiquement demandé à Bonn plus de clarté de la part du Brésil.
Le financement est la deuxième grande lacune. Certains pays en développement sont, à juste titre, mécontents des niveaux de financement reçus jusqu’à présent, ainsi que des prévisions pour l’avenir, en particulier lorsqu’on les compare aux besoins réels pour éviter des émissions élevées, s’adapter au changement climatique et répondre aux pertes et préjudices déjà en cours.
Un enjeu fort en émergence : la transition juste, condition d’acceptabilité et de coopération
La transition juste est une opportunité unique de connecter les COP à nos réalités du quotidien. Alors que l’action climatique se heurte à de multiples défis, économiques, sociaux, et politiques, la nécessité d’une Transition Juste devient incontournable. Dans un contexte de précarité croissante, de nombreuses personnes, qu’elles soient travailleuses, agricultrices, membres de communautés locales, s’inquiètent des conséquences que des mesures climatiques mal conçues pourraient avoir sur l’emploi, le coût de la vie ou l’accès aux ressources essentielles. Ainsi, la transition juste a été un enjeu vital au sein des débats. Celle-ci mobilise plusieurs paramètres comme la nécessité de ne laisser personne de côté dans la transformation des économies vers des modèles respectueux des droits humains et de l’environnement. Cela inclut notamment la diversification économique, la création d’emplois, la protection/justice sociale et la démocratisation de la gouvernance climatique.
La question de la confiance a elle aussi émergée comme un facteur central, notamment face à l’érosion provoquée par le lobbying de certains secteurs et la perception d’iniquité dans les mécanismes de financement et de transparence. La transition juste est perçue comme un levier permettant de restaurer cette confiance, à condition de garantir l’accès équitable aux financements et d’intégrer les droits humains, l’égalité de genre et l’équité intergénérationnelle. Enfin ce sujet de négociations peut permettre à la CCNUCC de livrer un résultat concret dès la COP30, notamment un mécanisme de coordination au niveau mondial pour la transition juste permettant aux États d’être accompagnés et de demander du soutien technique et financier pour les plus pauvres. Une coopération internationale est nécessaire pour renverser la logique actuelle de compétition autour des ressources. Nous savons que des accords d’investissement et de commerce sont conclus pour sécuriser l’approvisionnement en ces minerais, et au final, nous reproduisons toutes les erreurs qui ont été commises par le passé avec l’économie fondée sur les énergies fossiles. Cela peut être éviter grâce à la création d’un mécanisme dédié : dans un contexte où la confiance est fortement réduite entre les pays, ce genre de résultats peut permettre un ralliement.
Plan d’Action Genre – de la bonne volonté mais pas de prise en compte des discriminations croisées
Les parties ont montré une réelle volonté de collaborer pour parvenir à un projet de texte complet qui nous donne une bonne base pour la COP30. Il contient plusieurs éléments essentiels, notamment la santé et les droits sexuels et reproductifs, le travail de soins, la lutte contre les violences sexistes, les défenseures de l’environnement et des droits humains, l’intégration de groupes traditionnellement marginalisés (tels que les femmes d’origine africaine, les femmes handicapées et les femmes dans les communautés rurales) et une mention de la diversité des genres.
Cependant, il n’y a pas de véritable intégration de l’intersectionnalité, alors que ce cadre permettrait de saisir les différentes formes de discriminations croisées, les structures de pouvoir et d’identités que toutes les femmes et tous les hommes expérimentent face au dérèglement climatique et aux politiques climatiques. Le GAP n’a toujours pas de canaux clairs pour garantir une action climatique sensible au genre, et les discussions sur ce qu’est le genre – qui (rabachent) des différences culturelles bien connues – nous empêchent d’avoir des conversations plus progressives.
Ce qui est clair : Il n’y a pas de justice climatique sans justice de genre et les résultats de cette intersession doivent nous permettre de donner la priorité à l’adoption du plan d’action genre robuste et inclusif à Belem.
Agroécologie et sécurité alimentaire : une priorité pour les stratégies climatiques nationales et la COP30
L’agriculture est la seconde plus grande cause de la crise climatique et la transformation des systèmes alimentaires a été identifiée comme une priorité, avec un appel à intégrer l’agroécologie dans les stratégies climatiques nationales, dans le cadre d’une transition juste. Lors d’un atelier à Bonn, les discussions ont souligné l’importance de la souveraineté alimentaire, du soutien aux petits producteurs et productrices alimentaires, de la participation des jeunes, des femmes et des Peuples Autochtones. Ainsi, le soutien en fonds publics dédiés à l’agroécologie sont plus que nécessaires pour une transition juste des systèmes alimentaires, ainsi que la lutte contre la déforestation, notamment par la la réorientation des subventions néfastes et dangereuses qui y contribuent.
C’est maintenant à la présidence de faire de ce sujet un élément important de sa COP, avec la prise en compte des échanges lors du workshop à Bonn sur l’agriculture et délivrant à Belem un signal politique clair pour sortir de l’agriculture industrielle et soutenir les petits producteurs alimentaires qui nourrissent le monde. Un premier pas serait de lutter contre les conflits d’intérêts des grandes multinationales agro-alimentaires qui soutiennent des mesures opposées à celles décrites ci-dessus et de mettre en avant les petit.es producteur.ices et petit.es éleveurs / éleveuses, pastoralistes et pêcheurs artisanaux dans la COP.
Petit zoom sur un sujet négligé dans les COP depuis trop longtemps: l’adaptation au changement climatique
Sujet qui souvent ne débouche sur aucune décision, les sessions de Bonn cette année ont au moins permis de démontrer que l’adaptation ne peut plus continuer d’être ignorée.
En effet, elle est abordée depuis plusieurs années à travers des questions très techniques et méthodologiques, notamment (sur) quels sont les indicateurs pour mesurer les besoins, mais aussi sur les résultats. Si ces questions sont très importantes et complexes, elles cachent un autre élément systémique, qui est le manque de financement de l’adaptation au sein de la finance climat.
En effet, les États du Nord s’étaient engagés à doubler le montant de finance pour l’adaptation d’ici 2025. Même en atteignant l’objectif du Pacte de Glasgow sur le climat de doubler le financement de l’adaptation pour atteindre au moins 38 milliards de dollars américains d’ici à 2025, le déficit de financement de l’adaptation de 187 à 359 milliards de dollars américains ne serait réduit que d’environ 5 %. Et, il n’y a aucun plan disponible pour savoir si cette promesse sera bien effective à la COP30.
Lors des dernières heures de négociation à Bonn, sur l’objectif global d’adaptation, les pays riches ont tenté d’esquiver leur responsabilité, tandis que le Sud global se noie dans les promesses non tenues. Sans financement et moyens de mise en œuvre, l’objectif mondial d’adaptation reste un cadre creux, des mots sans action. Pour les communautés vulnérables, ce n’est pas un luxe. C’est une question de survie. Le Brésil a identifié l’adaptation comme un sujet majeur pour la COP30 : les négociations à Bonn ont avancé sur la partie technique des indicateurs, mais pas sur la finance, enjeu majeur. Il sera donc essentiel que l’équipe de la Présidence déploie toute sa force diplomatique pour s’assurer qu’il y aura bien des annonces de la part des pays développés au plus tard à Belèm pour mieux financer ce sujet, sinon les négociations resteront au point mort pour une année de plus.
De Dubaï à Belèm : comment faire un bilan mondial tangible?
En 2023, les États ont adopté une décision importante, résultant d’un processus d’évaluation de la CCNUCC, le Bilan Mondial. Après avoir passé deux ans à identifier les opportunités, les besoins et les barrières de la transition écologique, les États ont pu voir où ils devaient faire mieux, notamment pour leurs prochaines Contributions Déterminées Nationales (CDN) à soumettre en 2025 (septembre date limite). Une des décisions les plus fondamentales était celle de la nécessité de sortir des énergies fossiles de manière juste et ordonnée.
Alors en 2025, il est temps que les États montrent s’ ils ont vraiment pris en compte leur propre décision de 2023 : est-ce que leurs nouvelles CDN sont à la hauteur du Bilan Mondial ? Est-ce que la sortie des énergies fossiles, par exemple, est bien intégrée ?
Pour le moment, le résultat n’est pas du tout satisfaisant : 25 CDN ont été soumises, et elles sont rares à répondre au Bilan Mondial, notamment sur la transition énergétique2. Celle de l’Union Européenne est très attendue, car elle donnera le ton de l’ambition d’un des plus grands pollueurs historiques. D’ailleurs, en plein milieu des négociations, nous avons appris qu’Emmanuel Macron serait prêt à compromettre l’ambition climatique de l’Union européenne.
Au-delà de rendre le Bilan Mondial réel, à Bonn, les États ont tenté de négocier les modalités du prochain bilan, qui se fera en 2028. Malheureusement il y a un couac de taille, celui de l’alignement des calendriers du GIEC et de ce second Bilan Mondial. En effet, le GIEC prévoit de sortir son prochain grand rapport fin 2028, voire 2029, ce qui serait trop tard pour un Bilan Mondial qui devrait être bouclé en première partie d’année 2028, pour être validé fin 2028 à la COP33. Certains pays ne veulent pas accélérer le calendrier du GIEC pour correspondre à cette date butoire, pour des raisons qui s’entendent comme la nécessité de laisser assez de temps notamment pour les scientifiques du Sud pour y contribuer, mais aussi tout simplement car certains sont dans une croisade contre la science et tentent sa minimisation. Il est très important de contrer cette offensive et aussi de rassurer les pays qui ont peur que leur production scientifique ne soit pas bien intégrée, notamment en créant un soutien appuyé de la part du GIEC en ce sens. Les discussions vont continuer jusqu’à Belèm, en espérant que les pays arrivent avec un accord sur ces calendriers en novembre.
L’ombre de l’échec de la COP29 et le besoin criant de justice économique et fiscale
Lors des négociations, encore une fois la question de la finance climatique est apparue comme absolument centrale : sans financements solides, qualitatif (non générateur de dette) et pérennes, aucun progrès n’est possible. Il ne s’agit pas seulement d’exercice comptable, mais bien de justice et de responsabilité, un sujet profondément sensible qui nous renvoie à l’histoire coloniale de nos pays et aux logiques extractivistes qui ont aggravé la crise climatique dont on ne parvient pas à se sortir.
Plusieurs consultations ont été menées concernant la feuille de route « Baku to Belem » (1 300 milliards de dollars) ainsi que l’article 9.1 de l’Accord de Paris (les pays développés Partie fournissent des ressources financières pour venir en aide au pays en développement). Il sera essentiel que la présidence brésilienne, tout comme les pays développés, élaborent des stratégies de financement climatique à la hauteur des attentes et des besoins des pays du Sud d’ici la COP30. Il est irréaliste de penser que le secteur privé pourra, à lui seul, couvrir l’ensemble des besoins colossaux liés à l’atténuation, à la transition énergétique et à l’adaptation.
Nous avons besoin d’un système fiscal transparent, équitable et sensible au genre. Il est impératif d’intégrer les principes de pollueurs payeurs dans le régime international climatique.
Enfin, la question de la dette touchant particulièrement les pays du Sud a malheureusement manqué de traction politique. L’accumulation de dettes de ces pays limite la capacité d’investissement dans la transition et la résilience, renforçant les appels à des mécanismes de financement innovants, à l’annulation ou à la restructuration de dettes, et à une augmentation significative des flux financiers, Ces mesures (non exhaustives) sont jugées indispensables pour permettre aux pays les plus vulnérables de répondre à l’urgence climatique sans sacrifier leur développement social et économique.
La grande absente à l’agenda : la finance climat de sources publiques
Les États ont mis deux jours à démarrer les négociations car il manquait pour beaucoup de pays en développement le sujet crucial : la finance climat publique.
Rappelons nous, en 2024 à la COP de Bakou, il était question justement de mettre au point un nouvel objectif de finance climat, qui a abouti à un résultat plus que décevant : 300 milliards, soit un peu moins d’un tiers des besoins calculés pour soutenir les pays du Sud dans leur transition, mais aussi leur permettre de s’adapter au changement climatique et de réparer les pertes et dommages.
Quand on bâcle une COP, on finit toujours par le payer : avec ces 300 milliards dont on ne sait même pas la part de finance publique, celle qui est de meilleure qualité pour les pays du Sud, évidemment le sujet devait revenir sur la table à Bonn et a donné lieu à une consultation de toutes les parties. La présidence brésilienne doit développer une véritable stratégie pour les conversations sur la finance climat, sans se limiter à la finance privé. La présidence peut s’appuyer pour se faire sur la petite fenêtre que Bakou a laissé ouverte pour reparler du sujet, à savoir la feuille de route Bakou à Belém, dont les consultations ont été assez mitigées à Bonn, se concentrant principalement sur la finance via le secteur privé.
Le “Mutirão” : une tradition brésilienne inclusive au service de la COP30
Le concept de Mutirão, inspiré des traditions collectives brésiliennes a été mis en avant à Bonn comme pilier de la stratégie de la présidence brésilienne pour la COP 30. Le Mutirão se définit comme un effort collectif basé sur la solidarité et l’action partagée, mobilisant la société civile, les communautés locales, les peuples autochtones, les femmes, les jeunes et les défenseur.e.s de l’environnement pour passer des négociations à l’action concrète. La force du Mutirão réside dans sa décentralisation et sa capacité à intégrer les initiatives locales dans un mouvement global, tout en respectant l’autonomie et la diversité des acteurs impliqués. Il s’agit de garantir que les communautés les plus touchées par la crise climatique soient au centre des décisions et des solutions, et que leur sécurité soit assurée. Dans la préparation de la COP30, un élément est intéressant et assez nouveau, celui du sommet des peuples qui est organisé par les mouvements sociaux et par les peuples autochtones au Brésil. Cela devrait permettre un suivi populaire, centré sur les droits, qui imposera une pression supplémentaire sur les Etats en train de négocier.
Pour conclure : quelles COP pour le futur?
À Bonn, de nombreux acteurs ont souligné la nécessité de rendre les négociations et les documents accessibles dans davantage de langues et de formats, afin de favoriser la participation de toutes les communautés, notamment celles des peuples autochtones et des territoires les plus vulnérables. Cette ouverture est vue comme un levier pour renforcer la légitimité et l’efficacité des décisions prises au sein de la CCNUCC.
Car en effet, l’expansion massive des COP n’a pas abouti à des décisions meilleures et plus inclusives ; au contraire, elle a davantage ouvert la porte à l’industrie des combustibles fossiles et à d’autres gros émetteurs, leur permettant de continuer à polluer en toute impunité et à proposer des illusions coûteuses pour verdir leur image. Pour aggraver la situation, les discussions climatiques ont été organisées dans des pays présentant des bilans problématiques en matière de droits humains et des intérêts importants dans les énergies fossiles. La gouvernance climatique mondiale est de plus en plus perçue comme déconnectée des réalités, guidée par des intérêts particuliers, et en perte de pertinence et de confiance.
De fait, des discussions commencent sur la possibilité de réformer les modes de négociations afin de rendre la CCNUCC et ces COP plus adaptées au contexte actuel, plus efficaces : cela peut passer par un nouveau système de conception de l’agenda (qui ne pourront plus bloquer les négociations), rendre obligatoire pour les pays hôte des COP d’établir des garanties pour le respect des défenseurs et défenseuses de l’environnement à leur COP. Mais la société civile va plus loin, en demandant par exemple une politique de conflit d’intérêt à la CCNUCC (comme cela peut exister par exemple à l’Organisation Mondiale de la Santé). Dans le cadre des 10 ans de l’Accord de Paris, ces discussions seront centrales à la COP30 et au-delà.
1 https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/degrees-matter
2 Pour aller plus loin, le site de Climate Action Tracker : https://climateactiontracker.org/
-
-
-
-
Suivez les actualités du réseau
Abonnez-vous à la newsletter du Réseau Action Climat.